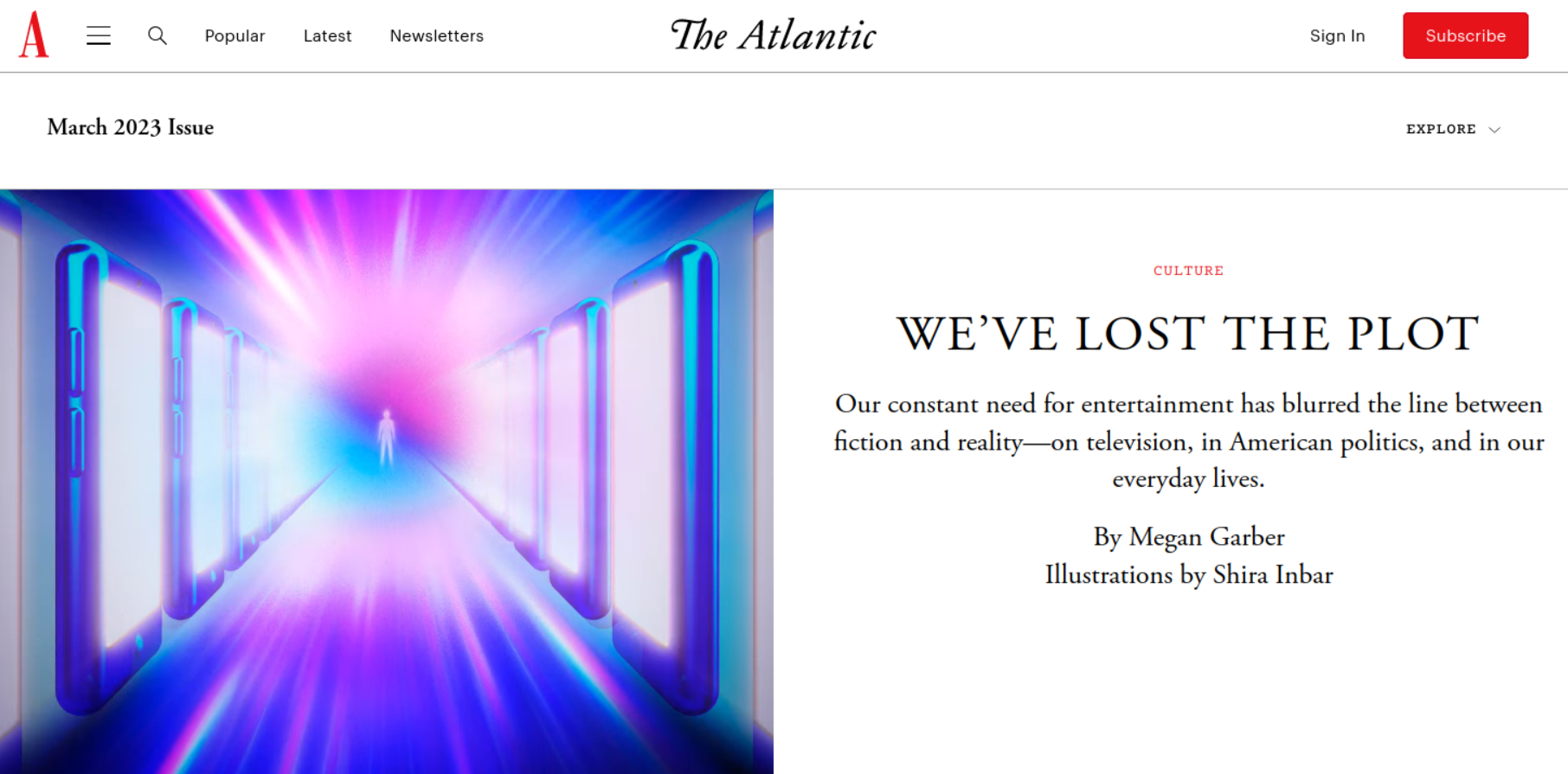La hype dure deux ans
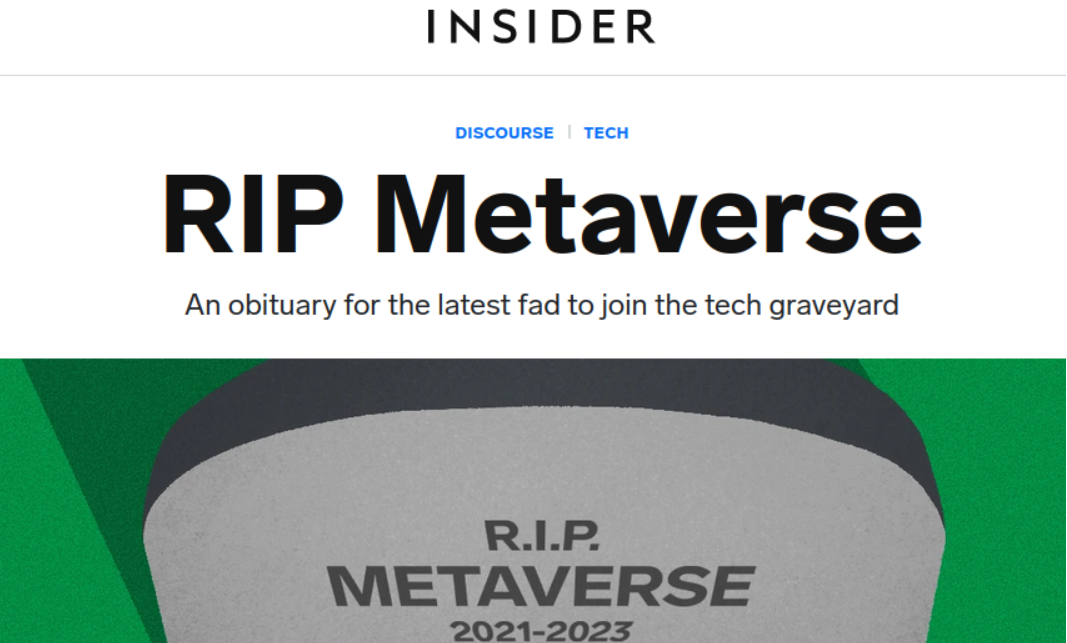
La semaine dernière, Nvidia a dépassé Facebook en capitalisation boursière au Nasdaq. Si cette phrase ne vous dit rien, c'est un peu normal – jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas sur BFM Business. Nvidia est une entreprise qui fabrique des puces graphiques (GPU). Traditionnellement utilisées dans le jeu vidéo ou le cinéma d'animation, ces GPU sont devenues l'infrastructure matérielle des hypes technologiques successives, des cryptomonnaies aux NFT en passant par les grands modèles de langage (LLM pour l'acronyme anglais de "Large language model") tels que ChatGPT. Sans une augmentation constante de la puissance de calcul des puces de Nvidia, c'est toute la ligne de production des automates conversationnels qui s'arrête. Compte tenu de la folie actuelle autour de l'IA, ces cartes graphiques sont devenues "considérablement plus difficiles à trouver que de la drogue", dixit Elon Musk le 23 mai dernier alors qu'il venait d'en acheter 10 000 le mois précédent. Cerise sur le gâteau : Nvidia n'a pas réellement de concurrence dans le domaine.
Financièrement, tout va donc plutôt bien pour l'entreprise, comme on peut l'imaginer : 28 % d'augmentation du profit au dernier trimestre, 170 % d'augmentation du prix de l'action en un an. Et donc, dans la foulée d'une démo d'un GPT-4 embarqué dans un jeu vidéo fictif, le 29 mai, la barre symbolique et délirante des 1 000 milliards (un billion) de dollars de capitalisation boursière franchie. Un club d'entreprises extrêmement fermé puisque seuls Google, Apple, Amazon et Microsoft en font actuellement partie. Oui, quatre des cinq "Gafam", dont il faudrait peut-être revoir l'acronyme. Au-delà du conte de fées techno-capitaliste, il est difficile de ne pas y voir un symbole : le marqueur d'une transhumance du capital financier d'un pâturage d'opportunités à un autre – d'autant plus ironique que Nvidia était également lancée dans la course au métavers. Une énième passade, ou le début de la fin du modèle économique dominant depuis plus d'une décennie ? Pour le moment, impossible de le dire.
Facebook a posé le genou à terre et prêté allégeance au souverain du moment. Vous l'aviez raté ? C'est normal.
Reste qu'à Zuckland, éjecté du club du billion l'année dernière, c'est un peu compliqué. Le 27 février, dans un timide post Facebook, Mark Zuckerberg enterrait tranquillement le métavers pour se concentrer sur le développement "de l'IA générative pour accélérer nos tâches". Dit autrement, Facebook a posé le genou à terre et prêté allégeance au souverain du moment. Vous l'aviez raté ? C'est normal. Abandonner le métavers quand on a rebaptisé son entreprise Meta deux ans et demi plus tôt, ça la fout mal. Malgré l'insistance de Mark Zuckerberg à assurer, mi-mai, que la firme est toujours positionnée sur le métavers, la relation du publicitaire Facebook avec les marques, passée d'extorsionniste à cajoleuse, raconte une autre histoire selon The Information.
Ça se comprend : entre 2021 et 2022, Reality Labs, la division "métavers" de Facebook, a perdu plus de 24 milliards de dollars. Son produit phare, Horizon Worlds, aurait moins de 200 000 utilisateurs actifs (sur un objectif de 500 000 fin 2022) dans son désert morne et laid aux graphismes dignes d'une Nintendo Wii. Les 10 000 embauches européennes claironnées dans toute la presse en octobre 2021 ? Balayées par deux tournées de licenciements consécutives, qui ont mis près de 21 000 personnes à la porte en six mois, soit 13 % des effectifs mondiaux. Les beaux jours de la valorisation à 1 000 milliards de dollars, atteinte un jour de juin 2021, semblent appartenir à un autre siècle – avant de les plaindre, gardez néanmoins à l'esprit qu'à l'heure d'écrire ces lignes, Facebook navigue autour des 675 milliards de dollars, et que la faillite n'est pas pour tout de suite.
Bref, Zuckerberg a construit le Titanic et s'est embarqué dessus pour une traversée dont personne, à l'heure actuelle, ne peut prédire la destination – un bateau qui pesait tout de même 177 milliards de dollars d'investissements entre 2021 et 2022 selon le cabinet McKinsey. Le souci, c'est qu'il a embarqué des passagers, et que ces passagers sautent par-dessus bord les uns après les autres. En février, Microsoft a fermé métaboutique, virant sans préavis les 100 personnes de sa division "métavers industriel". En mars, c'était au tour de Disney (7 000 licenciements annoncés le 31 mai), suivi de près par le géant états-unien de la grande distribution Walmart (2 000 licenciements en avril).
Les champions d'hier, premiers de cordée sur l'immobilier virtuel comme Decentraland, Axie infinity ou The sandbox, ont perdu l'essentiel de leur valeur boursière et la majorité de leurs utilisateurs·rices, constatait The Block en avril. Le métavers se vide, inexorablement. S'il vous fallait une dernière preuve que le concept est foutu, Apple vient de la fournir à toute la planète avec la présentation de son casque de réalité mixte (XR), le "Vision Pro", qui semble faire tout son possible pour éviter la comparaison avec l'interface de Facebook, analyse la newsletter Garbage Day. Quand la marque la plus normative au monde indique la direction du vent (ici, la réalité augmentée plutôt que virtuelle), on peut être sûr que le monde entier va la suivre. RIP donc petite révolution partie trop tôt.
Une hallucination collective de cette ampleur obscène ne vient pas de nulle part : Zuckerberg en est certes le principal architecte, les cabinets de conseil et les fonds d'investissements aussi, mais la presse généraliste a joué à fond son rôle de relais de hype à la fois docile et émerveillé.
La tentation de hurler on vous l'avait bien dit est vraiment, vraiment irrésistible, d'autant plus que la perspective de voir des fonds d'investissements de Wall Street perdre l'équivalent de la dette extérieure de la Nouvelle-Zélande dans une version d'internet pour avatars flottants sans jambes suffit à égayer la journée. Mais ne nous éparpillons pas, fut-ce dans une saine et juste haine des parasites du Capital. Car le problème, c'est que quand la finance se plante, ce sont des dizaines de milliers de vies abîmées en bout de chaîne. Le sourire laisse alors place à la colère, et à la furieuse envie de pointer des responsabilités. Une hallucination collective de cette ampleur obscène ne vient pas de nulle
part : Zuckerberg en est certes le principal architecte, les cabinets de conseil et les fonds d'investissements aussi, mais la presse
généraliste a joué à fond son rôle de relais de hype à la fois docile et émerveillé pendant plus d'un an, de fin 2021 à fin 2022.
Il y a quelque chose de fascinant à mesurer l'évolution du discours médiatique au sujet du métavers. Ces dernières semaines, alors que les journalistes n'ont plus d'yeux (mi-énamourés, mi-effrayés) que pour l'intelligence artificielle et les multiples apocalypses qu'elle promet, la presse semble parallèlement avoir acté la rupture avec son précédent flirt technologique. Ainsi du Guardian, dont le chroniqueur John Naughton titrait, le 13 mai, "Une minute de silence, s'il vous plaît, pour le décès du métavers de Mark Zuckerberg". Ou du New York Mag, qui se demande tout haut, le 10 mai, d'où a pu venir "une idée aussi ridicule" (et propose une explication : la pandémie, durant laquelle "les bureaux vides et le nouveau pouvoir donné aux employés ont rendu les cadres de la tech complètement dingues"). Ou du Wall Street Journal qui, le 29 mars, transformait "métavers" en "meh-taverse". Ou enfin de Business Insider, qui consacre deux nécrologies au métavers en une semaine, les 8 et 14 mai.
Des bilans au vitriol qui arrivent tard, bien trop tard, comme au sortir d'un long coma critique… dont tous ne sont d'ailleurs pas encore sortis : le New York Times titrait encore le 19 février que "le prochain marché de l'immobilier" était dans le métavers, et l'inénarrable BFM Business organisait le 2 mai dernier une émission complète "en immersion" dans le monde virtuel agonisant. Par comparaison, dans la presse spécialisée, on pouvait lire dès octobre 2021 chez PC Gamer "Le métavers est une connerie".
Il ne faut pas aller bien loin dans la recherche pour retrouver des articles aux promesses absurdes. Comme lorsque le Wall Street Journal assurait en février 2022 que le métavers allait propulser le monde du travail dans la science-fiction (le même genre d'inanités qu'on peut lire aujourd'hui avec ChatGPT). Ou lorsque le New York Times se demandait si on s'y trouvait déjà sans le savoir. Ou lorsque Libération publiait, en août 2021, un édito pour nous exhorter à "rentrer dans le game" sous peine de nous faire déposséder de l'avenir par le cartel habituel de la tech – inquiétude par ailleurs totalement justifiée. Les exemples sont innombrables : au sortir de la pandémie, collectivement hébétés par un an et demi de privations sociales, nous étions peut-être mûrs pour accepter le pacte faustien proposé par Mark Zuckerberg – un patron dont la carrière, rappelons-le, se résume à une litanie de mensonges. Pacte légitimé par des cabinets de conseils reconvertis en oracles à surenchères, comme le cabinet Gartner, qui assurait en février 2022 que d'ici 2026, "25% des gens" passeraient "une heure par jour au moins" dans la vision malade de Zuckerberg. Fondamentalement, le métavers était une hype d'investisseurs désespérés, qui rêvait de se réaliser contre les faits, le bon sens et l'avis général. Une hype à obsolescence programmée qui a donc duré deux ans, le temps que le zeitgeist pandémique s'estompe et que les venture capitalists migrent sous d'autres tropiques.
Lorsque la volonté de quelques gros acteurs du marché de la tech impose un hyperréel avec le concours de la presse, cette dernière se rend effectivement coupable de désinformation.
On pourrait en rire, dire qu'on s'est bien fait avoir, qu'on vivait quand même un moment particulier de l'histoire des sociétés. Le problème, comme l'écrivait brillamment le journaliste d'Insider Ed Zitron début 2022, c'est que les enjeux sont un peu plus élevés que ça. Lorsque la presse "écrit aveuglément des articles à la «qu'est-ce que le métavers?» ou «Pourquoi vous devez prendre Meta au sérieux», elle participe volontairement à la propagande de Zuckerberg", écrit-il. En effet, "chaque entreprise qui suit la direction de Zuckerberg et parle de la manière dont «le métavers représente l'avenir» en recyclant de vieux concepts se lance dans une forme ignoble de désinformation". Le mot est lâché, le mal est nommé. Lorsque la volonté de quelques gros acteurs du marché de la tech impose un hyperréel avec le concours de la presse, cette dernière se rend effectivement coupable de désinformation.
Les raisons économiques et idéologiques sont parfaitement compréhensibles, à défaut d'être excusables : précarité, grégarisme, course à l'audience, formatage idéologique, recherche de sensationnalisme, manque de formation, de temps, de capacité critique, de connaissance du contexte socio-technique, etc. Reste le factuel: relayer les fictions techno-utopiques de chargé·es de com' ou de cabinets de conseils, quand bien même au conditionnel, quand bien même pour faire ensuite jouer un service minimum de "contradictoire" en fond d'article, c'est mettre en jeu sa réputation de corps intermédiaire de vérification pour les légitimer, les faire entrer dans l'environnement des faits indiscutables. Bref, participer activement, redisons-le, à désinformer. A quel point? Selon une étude britannique du Reuters Institute en 2019 sur la couverture de "l'intelligence artificielle" par la presse locale, 60% des articles parus l'étaient sur des annonces de nouveaux produits, réels ou non, 30% des articles étaient basés uniquement sur des sources industrielles et, peut-être le plus ridicule, 12% des articles mentionnaient Elon Musk, vendeur de crédits carbone à l'industrie automobile étasunienne et PDG de Twitter.
C'est d'autant plus énervant que la presse sait. La presse n'en est pas à sa première hype. La presse devrait maintenant savoir comment couvrir avec sérieux et distance critique ces événements marketing manufacturés, ne serait-ce que parce que la Columbia Journalism Review publiait une liste de bonnes pratiques dès 2022 : éviter de parler de technologies au futur, à plus forte raison lorsqu'elles existent déjà ; sortir de la vision strictement technique ; briser la relation symbiotique avec le secteur privé en donnant la parole aux institutions, aux ONG et aux critiques ; surtout, éviter le cycle de la hype. La presse sait que l'écosystème des start-up a besoin d'elle pour alimenter la machine à paillettes et la convertir en rounds de financement qu'elle pourra ensuite cramer dans des campagnes de com' à destination des futurs acheteurs. La presse sait qu'une fois la sidération passée, la hype se révélera pour ce qu'elle est : une solution en recherche de problème, une célébration du vide, une gigantesque perte de temps, d'argent, d'attention et d'énergie pour une contribution absolument nulle au bien collectif. Et pourtant, la presse continue de le faire.
Le champ médiatique devient une sorte de battle royale frénétique de concepts survendus empilés les uns sur les autres dans une grande mêlée à mort pour tenter d'être le dernier debout et attirer tous les capitaux mis en jeu.
Année après année, la couverture du marché de "l'innovation" ressemble de plus en plus à un grand marché aux puces de la hype, où les cycles (identifiés, ironiquement, par le cabinet de conseil Gartner) deviennent si rapprochés les uns des autres que le champ médiatique devient une sorte de battle royale frénétique de concepts survendus empilés les uns sur les autres dans une grande mêlée à mort pour tenter d'être le dernier debout et attirer tous les capitaux mis en jeu. Les hypes cohabitent, fusionnent (comme le web3 et les cryptomonnaies), s'additionnent ou s'annulent. Les récits publicitaires s'entrechoquent. L'an dernier, le designer allemand Johannes Klingebiel proposait une taxonomie des cinq types de hype, sorte d'échelle de Richter de l'intensité du délire médiatique autour d'un récit marketing, qui va de l'exagération légère des capacités existantes de l'outil (niveau 1) à un discours quasi-sectaire où la technique rend possible une société utopique (niveau 5). Le métavers est une hype de niveau 3. Dans sa version 2023, l'"intelligence artificielle" oscille entre les niveaux 4 et 5.
Mais il n'y a pas qu'elles. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les micro-hypes passées, et à leurs devenirs factuels. L'Hyperloop (niveau 1) qui devait connecter Londres à New York en 55 minutes ? La rencontre avec le monde réel s'est mal passée. Les magasins sans employés d'Amazon ? Fermés les uns après les autres dans le plus grand des silences médiatiques, comme le faisait remarquer le sociologue Antonio Casilli sur Twitter en mars. La livraison par drones ? Au cimetière. Le projet de ville intelligente et privée construite par Google à Toronto ? Abandonnée avant même la première brique posée. La réalité augmentée de Magic leap ? Les taxis volants, autonomes, volants et autonomes ? Les NFT ? Le web3 ? Bullshit, bullshit, bullshit.
Tout était fabrication, promesse, hyperbole. Et nous avons (presque) tout gobé, trop heureux d'être autorisés à rêver de futurs commercialement viables.
Tout est récit, prêt à être transformé en série documentaire par Netflix ou HBO, comme se lamentait récemment The Atlantic. Tout était fabrication, promesse, hyperbole. Et nous avons (presque) tout gobé, trop heureux d'être autorisés à rêver de futurs commercialement viables. Comme si la consumer tech nous embourbait dans une mélasse d'infotainement futuriste, jusqu'à nous rendre temporairement amnésiques à nos fondamentaux journalistiques. Côté lectorat, c'est pire : plus le récit publicitaire s'impose dans le paysage médiatique, plus la surcharge informationnelle devient hurlement, plus la vérification factuelle nous paraît fade et la réalité technique floue.
Le métavers n' est que la dernière preuve en date de cette épidémie de crédulité. Et il n'est pas difficile de parier que l' "intelligence artificielle", telle que présentée ces temps-ci, en sera la prochaine. À moins que l'on décide de revenir à des fondamentaux un peu dingues. Comme le fait d'attendre d'avoir un dispositif technique fonctionnel entre les mains pour en parler, au lieu de s'extasier devant des bande-démo aux rendus falsifiés. Ou d'arrêter de donner du crédit à la parole de multimilliardaires dont la fortune dépend directement de la capacité à vendre du mensonge grandiloquent. Ou de cesser de couvrir les grand-messes techno-religieuses qui, la plupart du temps, n'apportent au public que l'information que l'on s'y trouve bel et bien, en les laissant aux seul·es influenceurs et influenceuses, qui sont au moins payés grassement pour relayer la com' des constructeurs et n'ont pas, contrairement aux journalistes, le devoir moral d'obéir à la charte de Munich.
Et si on choisissait de penser le futur comme un processus plutôt qu'une destination, comme le préconise l'anthropologue Genevieve Bell dans son essai Divining The Future ? Et si on s'incluait dans ce processus de transformation, plutôt que de continuer à subir les visions dysfonctionnelles d'une techno-élite uniquement désireuse de consolider son influence sur le monde ? Et si, pour briser le cycle de la hype, mais aussi pour nos santés mentales (y compris celles des journalistes, nous apprend Pauline Grand d'Esnon), on reprenait la main sur la temporalité ? Et si on arrêtait de produire de la "malbouffe informationnelle", comme l'écrit Pauline, pour se remettre à informer ?
Cet article est libre d’accès
En vous abonnant, vous contribuez
à une information sur les médias
indépendante et sans pub.
Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous