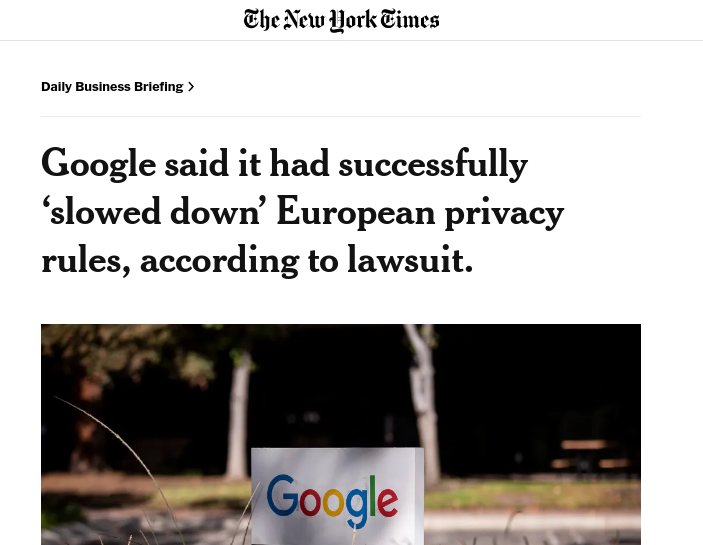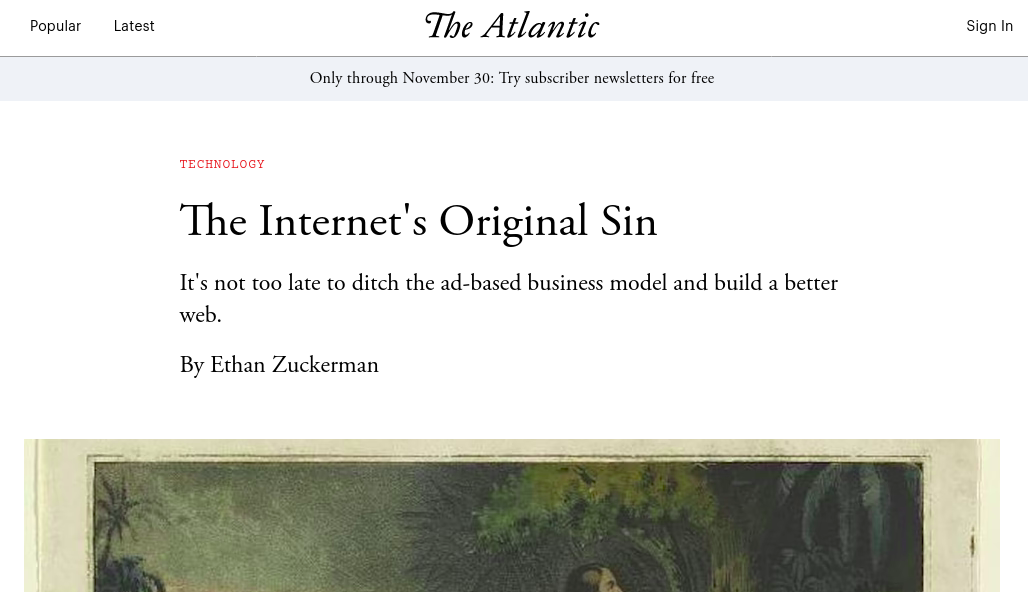Le web est un jardin emmuré

… et Facebook devint "Meta". Ce vendredi 29 octobre, Zuckerberg lançait avec toute la pompe numérique possible le grand ravalement de façade de son Facebook, relégué au rang de simple filiale d'un conglomérat, Meta donc, conçu comme une sorte de géant du BTP numérique dont l'objectif est – paillettes, trompettes et tambours – de construire le métavers
, cet univers en réalité virtuelle qui devrait enterrer internet sous dix à quinze ans. En 2015, Google, devenu suffisamment gros pour être menacé de fragmentation, jouait le même tour de prestidigitation pour devenir Alphabet, conglomérat contenant Google-le-moteur-de-recherche et les autres filiales. La salade n'est donc pas hyper fraîche, mais Zuckerberg s'est donné beaucoup de mal pour nous la vendre, alors arrêtons-nous dessus le temps de quelques phrases.
Regardez cette présentation. Bon, okay, juste quelques minutes – de quatre à six minutes, précisément. Observez le fantasme de pouvoir totalitaire – camouflé en jeu vidéo existentiel – pour lequel Zuckerberg et Facebook Reality Labs s'apprêtent à claquer dix milliards de dollars rien que l'année prochaine. Ressentez ce vertige, cette sur-sollicitation constante de notifications, ces allers-retours incessants entre plans d'existence – réalité physique, réalité mixte, réalité virtuelle –, savourez l'angoisse inédite que vous propose cette cosmocratie, ce Zuckervers encore au stade embryonnaire mais déjà tonitruant. Toute la philosophie de Meta est contenue dans son étymologie – meta, l'entreprise réflexive qui ne voulait plus parler d'autre chose que d'elle-même ; meta, la multinationale de la transcendance, qui concocte un super-monde pour les übermensch du 21e siècle. En aller simple.
Ce que nous propose le PDG de Facebook – pardon, Meta –, comme l'identifie parfaitement Olivier Ertzscheid sur son blog Affordance
, c'est une privation sensorielle. Un univers fermé, partiellement coupé du monde physique, à l'intérieur duquel on sur-interagit avec les autres, où l'on se surexpose, où la surcharge sensorielle devient la norme. Objectif : générer des niveaux d'engagement (donc d'attention, donc de données comportementales, donc de modélisation de comportements d'achat, donc d'espaces publicitaires efficacement convertis en actes de consommation, donc de profit) supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux générés par le modèle actuel. Une orgie de stimuli, tout le temps, jusqu'à ce que le quart d'heure de silence devienne un produit de luxe. Ne plus simplement "connecter le monde", comme le prétendait jadis Facebook, mais l'incarcérer dans un labyrinthe de possibles. Le nouveau titre boursier de Meta, l'entreprise qui voulait tout relier et faire sauter les frontières du réel, s'appelle MVRS (et on ne sait pas vraiment pourquoi).
Murs.
Ce n'est pas seulement une cocasserie sémantique de ma part. Ces dernières semaines, on parle énormément de murs
dans le monde de la tech. Le "mur" Facebook, pour commencer, qui se retrouve au cœur de la nouvelle salve de Facebook Papers – si vous avez une légère impression d'écho, c'est normal, la précédente chronique en parlait déjà. Ce mur, donc, où l'ordre des publications affichées est déterminé par un algorithme, qui calcule pour chaque post un score d'intérêt (on appelle ça une éditorialisation, mais ne le dites pas à Facebook, ça les agace). Une sorte de score de crédit social à la chinoise, mais pour vos publications.
Ces passages nouvellement révélés cartographient un territoire numérique où Google règne en maître absolu : celui de la publicité en ligne.
Sauf que le système, à force de mises à jour dans tous les sens, est devenu une sorte de chimère gigantesque, dont personne ne comprend plus le fonctionnement. Ce qui est problématique quand, nous apprend le Monde le 26 octobre, "avec le temps et l'accumulation de nouveaux signaux ajoutés par les
ingénieurs du réseau social, le «score» moyen d'un message (post, ndlr) a explosé. Dans un document non daté, un analyste de Facebook a procédé à quelques
calculs, et constate que pour certains contenus, le score «peut dépasser 1 milliard». Ce qui a pour conséquence très directe de rendre de nombreux outils de modération inopérants." À force de compartimenter ses équipes pour éviter les fuites, Facebook a créé un monstre dans sa propre arrière-cuisine. Les murs construits dans l'entreprise ont engendré la défaillance du mur numérique, qui ne peut plus être modéré correctement.
Enfin, il y a quelques semaines, un autre mur est tombé : celui du secret. Le 22 octobre, à la demande de 23 rédactions (le New York Times
, le Washington Post, Politico
, etc...) un juge de New York a rendu publiques les pièces (jusqu'ici caviardées) du dossier judiciaire contre Google lié à une plainte "antitrust" déposée il y a deux ans par seize États états-uniens. Les révélations sont saisissantes, et le géant du web peut s'estimer heureux qu'elles arrivent exactement au même moment que les "Facebook Papers", qui donnent déjà suffisamment de travail aux journalistes tech (en France, seuls Numerama et les Échos ont couvert ce second scandale).
Ces passages nouvellement révélés cartographient un territoire numérique où Google règne en maître absolu : celui de la publicité en ligne, qui fonctionne selon un système complexe et opaque d'enchères en temps réel où les espaces publicitaires sont distribués aux annonceurs les plus offrants (évidemment, tout est automatisé). Ce type de publicité, dite programmatique, représente 70 % du marché mondial. On apprend que la plateforme d'enchères de Google, Adx, traite onze milliards (!) d'espaces publicitaires par jour, soit "plus de transactions que le Nasdaq et le NYSE combinés". Or, Google détient également les plus importants logiciels d'achat et de vente d'espaces de publicité, ce qui lui permet de régner sans partage sur le marché et de prélever des commissions à sa guise, qui peuvent aller jusqu'à 42 % – autant de revenus publicitaires qui échappent aux médias en ligne, par exemple. Dans la vraie vie, à la Bourse, c'est comme si LVMH détenait le CAC 40, et qu'il n'existait que cette place boursière.
Google a passé un accord secret avec Facebook pour l'avantager sur sa plateforme d'enchères : neuf fois sur dix, Facebook gagnera l'enchère, même en proposant un prix plus bas, garanti.
Il y a pire. En 2017, confronté à la seule entité capable de venir concurrencer son monopole – Facebook, qui réfléchit alors à se lancer dans les plateformes d'enchères publicitaires –, Google a passé un accord secret avec Facebook pour l'avantager sur sa plateforme d'enchères : neuf fois sur dix, Facebook gagnera l'enchère, même en proposant un prix plus bas, garanti. Nom de code du pacte de non-agression : Jedi Blue. Le monopole de la pub en ligne devient alors un duopole, qui pèse aujourd'hui près de 80% de la publicité en France, rappelait Libération en 2018. Pour tous les autres, l'illusion du libre marché est totale. Tout est sous contrôle. Et les documents ne s'arrêtent pas là. Le New York Times raconte que Google, lors d'une réunion d'août 2019 avec Microsoft, Apple et Facebook, se plaint que Microsoft et Facebook fassent des efforts pour respecter la vie privée de leurs utilisateurs, particulièrement celle des enfants. Lors de cette même réunion, Google se félicite d'avoir "ralenti et décalé [la régulation européenne ePrivacy] en travaillant main dans la main, en coulisses, avec les autres entreprises". Parallèlement, Google aurait sciemment dissimulé les réglages permettant de refuser la collecte de données de géolocalisation sur mobile.
Enfin, les documents révèlent l'existence du projet NERA, une tentative de modifier le navigateur Chrome pour le transformer en puissant outil de surveillance et, à terme, "imiter avec succès un jardin clos à travers le web ouvert" – en d'autres termes, privatiser et fermer une partie du web. Des murs, partout, tout le temps. Pratiques de cartel, complot, délits d'initiés, pratiques anti-concurrentielles… comme le résume un développeur sur Twitter, "soit Google est foutu, soit la société est foutue". Sur le site spécialisé The Register, même ambiance, et même appel au démantèlement : "C'est eux ou nous, et il faut que ce soit nous." Eux et leur impérialisme. Eux et leur philosophie éternelle : celle du "jardin clos" (hortus conclusus), de la propriété privée, de l'écosystème fermé, contrôlé et surveillé – le terme vient de l'anglais, "walled garden", qui décrit des jardins fermés permettant de créer et contrôler des microclimats.
En 2005 déjà, pour le Monde, Olivier Ertzscheid expliquait que Google "a l'ambition, et probablement les moyens, de devenir un guichet d'accès
unique à l'information. Cette volonté centralisatrice, dans un univers
aussi décentralisé qu'Internet, est une gageure et un non-sens." La même année, le journaliste Hubert Guillaud délivrait cette prophétie : "Comme Microsoft avant lui, Google dessine son avenir sur le fil d'un
couteau. […] Nous verrons à l'usage ce qu'il en est.
Ce qui est sûr, c'est que nous devons avoir confiance dans les
utilisateurs qui savent, plus que quiconque, brûler ce qu'ils ont tant
aimé. «En auront-ils encore la possibilité ?»
,
s'interrogeront les
plus pessimistes : à moins de penser que l'internet soit une zone de
non-droit, oui." Tant pis pour l'optimisme que Guillaud affichait il y a quinze ans : internet n'est certes pas tout à fait une zone de non-droit, mais une ploutocratie, sans aucun doute. Et personne, à l'heure actuelle, ne semble être en mesure de menacer les géants du web.
Cette méthode à la fois expansionniste et carcérale, qui a fini par infecter les gouvernements – étendre le territoire de surveillance, centraliser les données captées dans d'immense silos – ne date pas d'hier. Le modèle économique publicitaire, "péché originel d'Internet" pour Ethan Zuckerman, est la fondation du jardin clos numérique contemporain. Du premier spam publicitaire, en 1978, à la première bannière numérique en ligne, en 1994, le web se contorsionne pour épouser la publicité, modifiant sa forme et ses fonctions, s'emmurant progressivement et dictant nos usages de consommation.
Le web, miroir politique du monde physique, né en 1989, s'emmure progressivement depuis trente ans.
Symbole de cette mutation, l'internet mobile est aujourd'hui totalement dominé par les jardins clos des applications : le navigateur web, traditionnelle porte d'entrée sur le réseau, ne représente plus que 10 % de l'activité sur smartphone. Pour une génération entière, Facebook, Instagram et consorts sont synonymes d'un accès à internet. Est-il seulement possible d'inverser le processus de balkanisation ? Oui, répondait Hubert Guillaud le 11 octobre. À condition que les régulateurs cessent d'entretenir l'illusion du démantèlement, et de pousser pour plus d'interopérabilité – des protocoles ouverts, des technologies compatibles les unes avec les autres.
Nous en sommes malheureusement loin. Après une quinzaine d'années de construction patiente, les enclos des Gafam délimitent désormais le web pour une immense partie de la population. Les murs sont partout. Aujourd'hui, deux tiers des recherches Google seraient des "zéro clic", des recherches qui ne donnent pas lieu à la consultation d'un site. Cette part était de 50 % en 2019. Petit à petit, le moteur de recherche devient un moteur de réponse. Petit à petit, en mettant ses propres services en avant, en ajoutant des nouveaux types de fenêtre de résultats (météo, résultats sportifs, photos, etc.), Google devient le web aux yeux des utilisateurs. Au point de réfléchir, depuis trois ans, à faire disparaître la barre d'URL de son navigateur – ce qui effacerait symboliquement l'une des dernières traces du web ouvert et décentralisé imaginé par Tim Berners-Lee.
Amazon et Microsoft, pendant ce temps-là, séquestrent nos contenus dans leurs serveurs cloud. Et Facebook, via son Metaverse de pacotille, voudrait maintenant réaliser le même tour de passe-passe… avec le réel tout entier. Est-ce si surprenant ? Le web, miroir politique du monde physique, né en 1989, s'emmure progressivement depuis trente ans. Dans le monde réel, même tendance à la claustration : il y a désormais quatre à cinq fois plus de murs de séparation (entre 60 et 75) qu'à la chute de celui de Berlin. Or, rappelle la Croix, une société murée est une société vulnérable et paranoïaque. Qui pourrit de l'intérieur, une brique à la fois.
Cet article est libre d’accès
En vous abonnant, vous contribuez
à une information sur les médias
indépendante et sans pub.
Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous